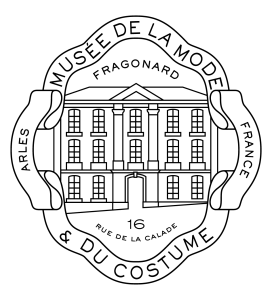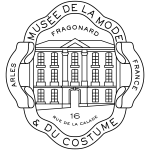Dirigez-vous maintenant vers la courette afin de découvrir l’œuvre vidéo de l’artiste Charles Fréger.
En chemin, vous passez devant un tableau inachevé du peintre arlésien Antoine Raspal. Il présente l’un des modèles posant pour l’atelier de couture de ses sœurs. Ce tableau illustre le soin que les Arlésiennes apportaient à leur mise, ainsi que les gestes distinctifs qui les rendaient reconnaissables et identifiables.
Ces gestes, liés à la coiffure et au vêtement, ont évolué au gré des modes jusqu’au début du XXᵉ siècle.
Installez-vous maintenant dans la salle de projection.
Dans son œuvre, Charles Fréger nous dévoile, à contre-jour, les gestes contemporains des Arlésiennes du XXIᵉ siècle.
Avec une minutie extrême, ces femmes coiffent leurs cheveux autour d’un peigne structurant, puis enroulent un ruban de coiffe qu’elles fixent avec des épingles. Une fois coiffées, elles enfilent, un à un, les éléments du costume dans un rituel parfaitement maîtrisé : jupons, corset, faux-culs qui soutiennent la jupe, et corsage appelé « aise ».
Sur ce corsage viennent se superposer plusieurs pièces : un devant d’estomac, une guimpe, un fichu de propreté en gaze ou en tulle plissé, et enfin un fichu d’apparat.
Le tout est fixé uniquement avec des épingles : une véritable architecture de plis, composée pour un usage unique, le temps d’une journée ou d’une représentation.
Environ une heure et demie est nécessaire à la préparation d’une Arlésienne. Charles Fréger et ses modèles ont relevé le défi de vous révéler les secrets de cette préparation… en quelques minutes seulement.
Ces gestes sont hérités des Arlésiennes de la fin du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle. À cette époque, dans des versions plus simples, ces costumes étaient portés quotidiennement par la majorité de la population locale.
Pour poursuivre la visite, revenez sur vos pas et suivez la flèche vers la gauche pour traverser la petite galerie.